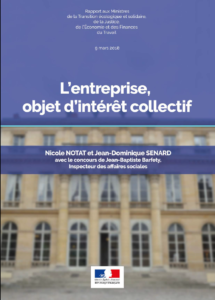Pour la rentrée 2018, les experts du Think Tank de la Philanthropie se sont réunis le 20 septembre, à l’Institut Pasteur. Au programme, un état des lieux sur la collecte de fonds, depuis la suppression de l’ISF remplacée par l’IFI, ainsi qu’un retour sur les 15 ans de la loi Aillagon, en évoquant notamment les menaces actuelles sur les déductions fiscales (hausse de la CSG, prélèvement à la source).

Daniel Bruneau, ancien directeur de la recherche de fonds et de la communication de l’association Petits frères des pauvres, a partagé les premiers résultats 2018 de la collecte de fonds. Comme attendu, la plupart des organisations ont constaté une baisse généralisée de 50% des dons IFI. Bien qu’il soit encore trop tôt pour connaitre l’impact sur la totalité de la collecte, le chiffre pour l’année 2018 s’annonce mauvais.
Sylvaine Parriaux, déléguée générale d’ADMICAL, a ensuite réagi à l’article « Mécénat : le gouvernement veut revoir les niches fiscales » publié dans Les Echos le 18 septembre. Elle est d’ailleurs revenue sur le communiqué qu’ADMICAL a publié en réponse à cet article. L’objectif étant de modérer le discours concernant les dérives sur les contreparties, qui en réalité ne concernent qu’un très petit nombre de mécènes.
Les experts ont clôturé le petit-déjeuner en convergeant sur l’enjeu pour le secteur non-marchand de réussir à mesurer et valoriser l’impact des externalités positives que peut avoir le mécénat.
Créée il y a plus de 10 ans, la donation temporaire d’usufruit (DTU) prend la forme d’un acte notarié par lequel le donateur transmet la disposition d’un bien à un organisme reconnu d’utilité publique. Ce dispositif peut s’appliquer aux valeurs mobilières ou immobilières. Il permet donc de faire sortir de l’assiette de calcul de l’IFI les biens dont l’usufruit est donné. En effet, l’assiette de calcul englobe les biens immobiliers ainsi que certaines parts de SCPI/OCPI et les contrats d’assurance vie ou de capitalisation[1].
La DTU : un format unique encore mal connu
Il existe encore peu de données chiffrées sur la DTU : nombre d’actes, valeur des biens concernés ou des produits versés à des organismes reconnus d’utilité publique… Alors que des progrès sensibles sont actuellement réalisés sur le chiffrage du mécénat d’entreprise, il est souhaitable que l’IFI et la DTU soient observés avec la même rigueur.
A ce manque d’information s’ajoute un manque de pédagogie. En effet, il semble que certains professionnels (conseiller en gestion patrimoniale, notaires, avocats…) soient encore largement réticents à sensibiliser sur l’outil que représente la DTU. Ce dispositif, avec le classique don-IFI, est pourtant devenu le seul moyen d’obtenir une réduction de son IFI, la déduction IFI PME ayant disparu au 31 décembre[2]. La DTU est d’autant plus avantageuse qu’aucun plafond n’est prévu : ni sur la valeur du bien laissé en usufruit, ni sur les produits que ce bien peut générer, la seule limite étant de nature temporelle : la DTU ne peut se conclure pour une durée supérieure à 30 années.
Pédagogie et simplification
Si les professionnels de la philanthropie ont des efforts de pédagogie à faire, le législateur pourrait, lui aussi, rendre plus aisée l’utilisation ou la mutation de la DTU. C’est par exemple le cas quand le bienfaiteur souhaite donner de manière permanente la nue-propriété du bien placé en DTU. Actuellement, la loi oblige les parties à attendre la fin de la période de DTU prévue pour pouvoir procéder au don de la nue-propriété en bonne et due forme. Permettre le transfert de la nue-propriété au bénéficiaire en cours de DTU serait un signe favorable envoyé au secteur caritatif et aux bienfaiteurs.
Un outil dans l’air du temps
En plus de son caractère unique, la DTU est également un formidable outil pour associer patrimoine et générosité. L’on peut ainsi imaginer un chef d’entreprise transférer une partie de l’usufruit de ses parts à un organisme d’intérêt public, faisant bénéficier de sa réussite professionnelle la cause qui lui est chère, tout en mettant son engagement au cœur de sa démarche entrepreneuriale.
Pour résumer :
- Pour les professionnels de la philanthropie, un travail à poursuivre pour mieux connaître et faire connaître la DTU ;
- Pour les professionnels de la gestion patrimoniale, une démarche philanthropique à adopter ;
- Pour les bienfaiteurs, un outil unique, l’un des rares moyens de bénéficier d’une déduction IFI et de conjuguer de façon innovante patrimoine et générosité.
Le 17 mai dernier, les experts du Think Tank de la Philanthropie se sont réunis à l’Institut Pasteur. Au cœur des échanges, un état des lieux et un point sur les perspectives de la finance solidaire avec Laurine Prévost, ainsi qu’une discussion avec Nicolas Duvoux sur la base de son article « Les hommes providentiels« .
Laurine Prévost, responsable des relations institutionnelles et des partenariats chez Finansol, a partagé une photographie de la finance solidaire en France (2M€ de placements solidaires). Si l’épargne solidaire ne représente aujourd’hui que 0,2% de l’épargne des Français, l’objectif de Finansol pour 2025 est qu’elle atteigne 1% du patrimoine financier des Français. Ont ainsi été abordés les défis que doit relever la finance solidaire, au premier rang desquels l’écart entre son faible rendement et les attentes du public.
Nicolas Duvoux, professeur et chercheur à l’Université de Paris VIII, est ensuite revenu sur l’article « Les hommes providentiels » publié en janvier dernier. Il a explicité le travail de 5 chercheurs américains dont l’ouvrage met la philanthropie en perspective avec les questions de démocratie et de justice sociale. La démocratie est évidemment la désignation de gouvernants par un ensemble de suffrages, d’élections, mais on peut aussi y ajouter une composante liée à la répartition de la richesse. On constate qu’aux Etats-Unis, de nombreux débats sur le poids et la légitimité de la grande philanthropie dans les causes de l’intérêt général émergent : les citoyens prennent conscience du poids que peuvent avoir certains acteurs commerciaux sur des sujets domestiques. Ce débat éminemment politique et idéologique est d’ailleurs présent à une toute autre échelle en France.

Parmi les formes multiples de la générosité des Français, le legs, bien que souvent peu médiatisé, demeure une source de financement primordiale pour les fondations. Près d’un tiers des ressources de ces dernières est en effet souvent conditionné par ces dons post-mortem. À titre d’exemple, le budget de la Fondation de France est alimenté par les legs des particuliers à hauteur d’environ 25 %.
De quoi s’agit-il ?
Juridiquement, le legs est un acte testamentaire ; en présence d’enfants, le patrimoine légué ne peut pas dépasser la quotité disponible, fonction du nombre des héritiers réservataires. Par ailleurs, le legs ne peut bénéficier qu’à certains types de structures, parmi lesquelles les fondations ou associations reconnues d’utilité publique ainsi que les fonds de dotations. Enfin, il peut prendre plusieurs formes (somme d’argent, biens immobiliers, œuvres d’art…) et être réparti entre plusieurs organisations (legs universel conjoint).
Toutefois, outre la réglementation en vigueur, la dimension humaine du legs est à considérer. Léguer, c’est décider de soutenir une cause, et c’est aussi une preuve de confiance forte accordée aux institutions légataires. Dès lors, ce sont des questions éthiques qui se posent et qui sont depuis quelques années en recomposition, selon Frédéric Grosjean, Responsable du service des legs et de la gestion du patrimoine immobilier de l’Institut Pasteur. Il souligne notamment : « La mentalité des testateurs a beaucoup évolué (…) ils ont besoin d’un contact avec les responsables de la fondation. Ils sont, d’une part, à la recherche de conseils techniques pour la rédaction de leur testament, et de l’autre, à la recherche d’informations quant à la manière dont leurs fonds vont être utilisés. »
L’avis des experts : Frédéric Grosjean, Xavier Delsol et Bernard Monassier
Frédéric Grosjean :
La libéralisation de la communication « depuis quatre à cinq ans » a indéniablement transformé le legs en « un sujet moins tabou ». Pour autant, aborder la fin de vie reste une question délicate, et ce d’autant plus que les profils rencontrés sont « souvent des personnes qui n’ont pas de famille et qui ont donc besoin de trouver un autre moyen de transmettre leur patrimoine ». Ainsi, plutôt qu’un contrat entre testateur et légataire, c’est une véritable relation, un dialogue qui voit le jour entre donateurs particuliers et responsables au sein des fondations. « Être à l’écoute » est alors une des principales qualités des professionnels de l’intérêt général. Il s’agit de s’inscrire dans une « démarche sincère et honnête » afin d’accompagner des testateurs qui souhaitent « être associés aux recherches et s’en assurer de leur vivant ». Cette préoccupation grandissante s’explique, pour Frédéric Grosjean, par une méfiance accrue en raison des divers scandales qui, par le passé, ont pu entacher la réputation de certaines institutions.
Afin de faire face à ces inquiétudes, plusieurs réponses sont apportées. D’une part, le testament comporte des éléments de plus en plus précis. Le testateur peut notamment indiquer, dans le cas d’un legs à l’Institut Pasteur, un champ de recherche médicale spécifique, destiné à la lutte contre une maladie en particulier. Vérifier qu’une équipe est bien en charge de ces projets et effectuer un contrôle a posteriori devient alors plus aisé pour les commissaires aux comptes de la fondation, En parallèle, ce sont également des exigences déontologiques redoublées qui sont au cœur des relations avec les testateurs. L’Institut Pasteur s’est doté de plusieurs outils : une certification ISO 9001 depuis 2011, qui garantit une relation humaine de qualité et prévient toute difficulté ; une Charte éthique et une Charte de déontologie, qui « fixent les conditions dans lesquelles sont entretenues ces relations. Il faut être à la fois intéressé pour l’institution mais désintéressé à titre personnel. »
Xavier Delsol :
Trois hypothèses se présentent au testateur afin de flécher les fonds qu’il décide de léguer. Au centre de ce choix : le degré de confiance. Ainsi, dans un premier cas, « le testateur peut donner à une structure qu’il ne connait pas mais en laquelle il a confiance car elle a une vraie notoriété. » Pour les fondations, soigner leur image et faire preuve d’honnêteté apparaissent, en conséquence, comme des éléments essentiels. Deuxième cas de figure, « le testateur peut donner à une structure plus petite, mais au sein de laquelle il connaît un membre du conseil d’administration. » Entre alors en considération une « confiance de proximité, d’ordre géographique affective ». Troisième option, le testateur opte pour « la création de son propre outil », à défaut de confiance en un organisme déjà existant. L’éventail qui s’offre à lui est large : fonds de dotation, fondation abritée ou fondation reconnue d’utilité publique (FRUP). Afin de déterminer quel véhicule juridique est préférable, Xavier Delsol met en avant la tension qui existe entre « contrôler de son vivant » et « contrôler a posteriori ». Si dans le premier cas le fonds de dotation semble plus pertinent, dans le second, la fondation abritée ou la FRUP sont plus avantageuses.
Bernard Monassier :
Le cadre juridique relatif à la rédaction du testament peut varier (testament authentique par acte notarié, testament mystique, testament olographe ou testament international). Cependant, « le rôle du notaire est primordial » dans chaque situation afin d’accompagner et de conseiller les testateurs. Il faut ainsi veiller au respect de la réserve héréditaire et « à ne pas oublier d’inclure dans le testament les conditions à remplir par l’organisme bénéficiaire désigné par le testateur ». Ces dernières sont d’autant plus importantes qu’il constate lui aussi chez les testateurs une préoccupation grandissante quant à « la qualité des organismes caritatifs », en raison de certaines failles de gestion observées dans certaines structures depuis une vingtaine d’années. Ce manque de confiance a par ailleurs causé la diminution du nombre de legs « dans des proportions considérables ». Une réalité alarmante mais passant actuellement inaperçue, car « entre le moment où un testament est rédigé et le décès du testateur, une période de 10 à 15 ans s’écoule en moyenne ». Dès lors, même si les réflexions conjointes entre notaire et testateur prennent en compte « la notoriété des institutions » légataires, les engagements éthiques apparaissent incomplets et il rappelle qu’à ce jour « les chartes de déontologie sont insuffisantes et n’assurent pas une véritable transparence ».
Souplesse juridique et déontologie : les recommandations du Think Tank
À l’heure où le legs reste « le plus gros vecteur de générosité » selon Frédéric Grosjean, il est important de développer des outils appropriés pour garantir l’harmonie au sein du processus de transmission et organiser une meilleure redistribution du patrimoine au service de l’intérêt général, afin de pallier les dérives d’une société d’héritiers.
D’un point de vue juridique, Xavier Delsol plaide pour davantage de souplesse dans le but de s’adapter aux volontés de chacun. Il suggère, par conséquent, de donner plus de poids aux fondateurs et aux successeurs au sein des fondations reconnues d’utilité publique. Il souligne également les débats relatifs à la réserve héréditaire : « Doit-on conserver le système français, issu du droit latin, où il est obligatoire de ne pas déshériter ses enfants ou tendre vers le droit anglo-saxon, qui laisse pleine autonomie au testateur dans ses choix ? »
Sur le plan éthique et déontologique, Frédéric Grosjean insiste sur la nécessité pour les fondations de se doter d’une « charte de déontologie ». Une démarche qui selon lui devrait être rendue obligatoire, et non plus optionnelle comme elle l’est aujourd’hui. Par ailleurs, il rappelle que « parler de la transmission de son patrimoine, ce n’est pas la même chose que faire un don ponctuel » et envisage ainsi la création d’un « statut du chargé de relation testateur ».
Bernard Monassier propose enfin de « revoir la règlementation et surtout le contrôle » des organismes caritatifs. Il imagine par exemple la mise en place d’une « structure commune à tous ces organismes mais composée de tierces personnes », structure qui serait en charge de vérifier plus systématiquement la fiabilité et la qualité de gestion des institutions bénéficiaires de legs. Il mentionne à ce sujet le rapport d’information* déposé à l’Assemblée nationale par le député Pierre Morange et présentant des pistes de réformes de la législation française dans ce domaine. La promotion du « contrôle interne » ainsi que de « l’évaluation » et la simplification du « contrôle externe » constituent notamment les piliers de cette réflexion.
___________
* Rapport d’information, « La gouvernance et le financement des structures associatives », présenté par Pierre Morange, octobre 2008
Les experts du Think Tank de la philanthropie se sont réunis le 15 mars dernier à l’occasion d’un petit-déjeuner.


Animés par Mme Sarah El-Haïry, députée de Loire-Atlantique, les échanges ont été vastes : professionnalisation du secteur caritatif, modification du Code civil, ou encore incitations fiscales au mécénat.
En ce qui concerne les modifications du Code civil, l’article 238 reste trop restrictif, alors que de plus en plus de fondations souhaiteraient par exemple aider les jeunes entrepreneurs. Il paraît donc nécessaire de réécrire cet article pour permettre le développement de cette forme de générosité. Il est essentiel de soutenir l’engagement sociétal de nos entreprises et de marquer le partage de la valeur.
Par ailleurs, la responsabilité pénale qui pèse sur les dirigeants du monde associatif est importante. Il faut donc qu’ils puissent se faire conseiller et accompagner si nécessaire. Plus les structures sont organisées, plus les donateurs sont rassurés. L’Autorité des normes comptables a compris ce problème particulier au secteur caritatif. Il faut travailler davantage avec cette instance.
Au niveau de l’engagement des jeunes, deux profils de philanthropes se dessinent : ceux pour qui les motivations fiscales au don sont essentielles, et ceux pour qui la cause est plus importante que la fiscalité. Ces derniers, souvent de jeunes philanthropes, veulent agir localement dans la société civile.
On observe une forte tendance à la création de fondations de nature entrepreneuriale. Il est nécessaire que le cadre fiscal actuel du mécénat évolue pour prendre en compte l’entrepreneuriat, et que les contraintes et les moyens soient mis en correspondance.
Enfin, l’importance de la communication a été soulignée, dans le but de dédramatiser les réformes et accompagner ces sujets. Il faut que les informations soient disponibles et que le secteur caritatif parle d’une même voix.
La générosité des Français se compte en milliards
La Fondation de France publie une étude sur le montant de toutes les formes de don.
Pour lire l’article de La Croix cliquez ici
Pour retrouver la synthèse cliquez ici
Retrouvez le rapport de Jean-Dominique Senard et de Nicole Notat : 14 propositions pour contrebalancer une certaine « dictature » du court-terme et des résultats financiers et une « prise du pouvoir par les actionnaires ».
Deux propositions retiennent notre attention :
- La proposition n°12 : reconnaissance dans la loi de « l’entreprise à mission » à condition de remplir 4 critères : l’inscription de la raison d’être de l’entreprise dans ses statuts, l’existence d’un comité d’impact doté de moyens, la mesure par un tiers et la reddition publique par les organes de gouvernance du respect de la raison inscrite dans les statuts et la publication d’une déclaration de performance extra-financière.
- La proposition n°14 : assouplir la détention de parts sociales majoritaires par les fondations, une mesure allant dans le sens des Fondations Actionnaires.
Pour lire le rapport dans son intégralité: cliquez ici.
Le 18 janvier s’est tenu le dernier petit-déjeuner des experts du Think Tank de la Philanthropie.

Les échanges ont porté sur l’impact sur les dons de la suppression de l’ISF au profit de l’IFI. Les projections pessimistes ont été relativisées car les donateurs déduisent sur l’IR et sur l’ISF, et que la motivation fiscale n’est pas exclusive.

Daniel Bruneau a rappelé que seulement 25% des donateurs déduisant des dons de l’ISF sont exclusifs (ne déduisent pas de dons de l’IR) et cela concerne surtout des petits ISF déduisant des petits dons. La proportion de donateurs exclusifs ISF baisse pour les plus gros patrimoines qui déduisent presque tous des dons de l’IR également.
C’est plutôt une bonne nouvelle comme le fait qu’environ 80% des donateurs déduisant des dons de l’ISF déduisaient également des investissements dans les PME. Cela ne sera plus le cas avec l’IFI, ce qui pourrait entraîner une réaffectation de ces montants vers les dons pour ceux qui voudront réduire leur IFI.
Les experts du secteur bancaire ont également partagé le ressenti de leurs clients. Ainsi, si certains clients prévoient de se déporter vers d’autres dispositifs fiscaux que ceux du secteur, d’autres envisagent de transformer leur donation temporaire d’usufruit en don de patrimoine. L’IFI peut aussi être perçu comme une opportunité, un nombre de plus en plus important de personnes rapatriant leur fortune en France.
Enfin, la discussion a porté sur la frontière entre le lucratif et le non-lucratif et la clarification de la doctrine fiscale quant à la capacité de collecte des entreprises.
Ces discussions seront plus approfondies lors du prochain petit-déjeuner.
Favoriser les dons et donations, c’est à la fois pérenniser les ressources
des fonds et fondations et transmettre l’envie de donner.
Une philanthropie efficace ne peut s’envisager sans un cadre juridique et fiscal qui l’encourage et la soutienne, notamment en matière de successions et donations. Dans un contexte d’augmentation continue de l’espérance de vie, deux raisons majeures doivent inciter à faire évoluer les textes en la matière afin de pérenniser les ressources des fonds et fondations et de diffuser une culture du don.
Une raison démographique tout d’abord. Parmi les générations issues du baby-boom, les décès n’auront de cesse d’augmenter dans les années à venir, conduisant mécaniquement à la hausse des montants transmis d’une génération à l’autre. Ainsi, selon un rapport de France Stratégie (Peut-on éviter une société d’héritiers ?), ces montants représenteraient aujourd’hui près de 19% du revenu des ménages, et entre 25 à 30% d’ici 2050, contre seulement 8% voilà 35 ans (soit un passage de 60 à 250 milliards d’euros constants depuis 1980).
Une raison économique ensuite. Depuis les années 90, du fait de l’appréciation de l’immobilier notamment, le patrimoine des Français a augmenté plus vite que les revenus, et de manière concentrée au sein des ménages les plus aisés. Ainsi, la valeur du patrimoine des Français équivaut aujourd’hui à près de 8 ans de leur revenu disponible net, contre une moyenne de 4,5 ans en 1980.
Dans le contexte actuel de croissance atone, la hausse des montants transmis porte le risque d’accentuer fortement la reproduction sociale, les mérites de l’individu important moins dans la constitution de son patrimoine, que le total des héritages perçus. L’augmentation de l’espérance de vie conduit alors à des héritages toujours plus tardifs, au détriment des jeunes générations, mettant à mal tant le dynamisme économique que l’accès à la démarche de don.
Eviter que l’héritage d’un fort patrimoine, à un âge avancé et par une partie restreinte de la population, ne vienne accroitre encore davantage les inégalités, tel pourrait être l’enjeu de la fiscalité à venir pour France Stratégie. L’organisme rattaché à Matignon a ainsi préconisé plusieurs mesures de réforme du régime fiscal dans un sens plus redistributif et égalitaire :
- une modification des règles d’abattement, afin de favoriser les transmissions de patrimoine plus précoces ;
- une taxation, non pas de l’héritage suivant un décès, mais du patrimoine total perçu par l’héritier au cours de sa vie. Ce taux de taxation augmenterait ainsi en fonction du montant de patrimoine hérité, quelle que soit l’origine et le degré de parenté. L’objectif est ici de répartir de manière plus diversifiée le patrimoine transmis aux nouvelles générations ;
- une dotation universelle de patrimoine. Versée par l’État, financée par une partie des recettes sur les transmissions, elle permettrait à chaque individu entrant dans la vie adulte de bénéficier d’un capital de départ.
L’impôt, tel que présenté ici par France Stratégie, perdrait cependant ainsi sa vocation première, puisqu’il représenterait dès lors plus un outil de redistribution égalitariste qu’une contribution économique pour l’intérêt général. La question est pourtant davantage de permettre une meilleure fluidité dans la circulation monétaire entre les générations, au service du dynamisme économique et de l’utilité sociale, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui.
Favoriser les dons et donations, c’est à la fois pérenniser les ressources des fonds et fondations et transmettre l’envie de donner.
Certains outils juridiques rendent déjà possible, dans une certaine mesure, la redistribution du patrimoine, par la renonciation anticipée à l’action en réduction par exemple (RAAR), mais restent peu utilisés car trop méconnus par les contribuables. D’autres outils, comme la donation temporaire d’usufruit (DTU), participent également au renforcement des ressources des fondations et mériteraient une utilisation plus large encore.
Les incitations et déductions fiscales ont, quant à elles, fait leurs preuves comme leviers efficaces du dynamisme économique et de la valorisation d’une culture du don. Elles visent avant tout l’efficacité dans la redistribution, plus qu’elles ne suivent une logique égalitariste. Il s’agit dès lors par ce biais renouvelé de stimuler les donations intergénérationnelles, et le plus tôt possible. On remarque en effet que donner est une habitude qui se prend tôt, dès avant 30 ans : plus on commence à donner tard, moins on donne.
Réformer le système successoral français, pour un meilleur dynamisme économique et une plus grande utilité sociale des donations, pourrait passer par la solution radicale de la suppression des droits de succession en ligne directe. La difficulté politique de l’entreprise, notamment via la modification de « principes ancestraux » repris par le Code Civil, incite surtout à proposer des améliorations de l’existant. Toutefois, les évolutions proposées ne cherchent pas à renverser l’équilibre fiscal lors de transmissions de patrimoine par une plus grande taxation, mais veulent inciter au don. Par ailleurs, c’est moins d’un quart des legs aux fondations qui sont concernés par la présence d’enfants dans la succession.
S’appuyant ainsi sur les observations et propositions des acteurs du secteur philanthropique – notamment le CFF dans son Livre Blanc de mars 2017, l’avocat fiscaliste Me Xavier Delsol (DELSOL Avocats), ainsi que sur divers travaux menés par des experts composant notre cercle de réflexion – le Think Tank de la Philanthropie propose de redynamiser la transmission en France à travers plusieurs pistes de réflexion :
- l’exonération des droits de mutation lors de transmission de patrimoine des générations détentrices vers les jeunes actifs (dès lors que les revenus de ce patrimoine bénéficient pendant une période restant à déterminer, mais par exemple de 15 à 20 ans à une œuvre d’intérêt général) ;
- la non soumission des donations consenties au moins 10 ans avant le décès du donateur au respect de la quotité disponible (qui fragilisent actuellement les revenus des fondations par les contestations possibles) ;
- la facilitation de la détention, par les fonds et fondations, de titres de propriété d’entreprises, afin de pérenniser les ressources de ces structures ;
- la réduction de la réserve héréditaire (et donc l’élargissement de la quotité disponible pour un testateur) afin de permettre le bénéfice de plus de déductions fiscales lors de transmission de patrimoine à des fondations (dans des situations spécifiques telles que des problèmes de gouvernances familiales ou des transmissions d’entreprises). Une modification de l’article 915 du Code Civil en ce sens, quoique politiquement difficile, pourrait être envisagée. Cela avait notamment été suggéré dans une proposition de loi de la sénatrice Marie-Hélène Des Egaulx du 11 juillet 2011, « visant à concilier philanthropie et droit des successions ».
L’enjeu est ainsi, sans aller jusqu’à la suppression des droits de succession en ligne directe, d’apporter des améliorations aux outils juridiques dans une logique d’efficacité́ de la redistribution au service de l’intérêt général. Il est néanmoins important de préciser que ces propositions ne sont pas unanimement portées par l’ensemble des membres du Think Tank de la Philanthropie.
Au-delà du caractère concret de ces propositions, du débat juridique qu’elles peuvent susciter, le sujet central doit rester la promotion et la stimulation du don entre les générations, la diffusion d’une culture de la transmission.
Découvrez la nouvelle édition (septembre 2017) du Tableau comparatif des fondations en France réalisé par Stéphane Couchoux, Responsable du secteur « Fondations, Mécénat & Entreprises » chez FIDAL et membre du Think Tank de la Philanthropie.