Le 12 mars dernier, le Think Tank accueillait Arthur Gautier, Professeur assistant à l’ESSEC Business School et Directeur exécutif de la Chaire Philanthropie de l’ESSEC, pour présenter aux experts son dernier ouvrage Vers une Philanthropie stratégique, co-écrit avec Anne-Claire Pache et Peter Frumkin et paru aux Éditions Odile Jacob.

Ce livre est une adaptation aux contextes culturel et juridique français de l’ouvrage The Essence of Strategic Giving écrit par Peter Frumkin. Véritable guide à l’usage des philanthrope français et de ceux qui s’interrogent sur la meilleure manière de donner, on y décrit les 5 dimensions d’une stratégie philanthropique permettant d’optimiser son impact sur la société.

Arthur Gautier rappelle aux experts qu’il s’agit là d’un modèle philanthropique universel, dans lequel les cinq questions clés peuvent être pensées sans ordre particulier. Alors que certains philanthropes ont dès le départ une idée très précise de la cause qu’ils souhaitent soutenir, d’autres auront, quant à eux, choisi en premier lieu le niveau de visibilité qu’ils souhaitent donner à leur engagement.
Quelles sont mes valeurs ? Auprès de qui donner ? Quand donner et combien de fois ? Quelle structure juridique choisir ? Tant de questions qui n’avaient jamais été formalisées jusqu’alors, et qui sont pourtant essentielles dans l’acheminement et la réflexion personnelle d’un philanthrope.
Des échanges fructueux avec tous les experts ont suivi la présentation de ce modèle, confirmant de par leur expérience terrain sa pertinence et son utilité.
Découvrez le Podcast :
Pour cette nouvelle année 2020, les experts du Think Tank de la Philanthropie se sont réunis le 23 janvier à l’Institut Pasteur et accueillaient Pascal Boulenger, co-fondateur et directeur de MeilleursAgents Patrimoine, pour échanger sur le thème « Immobilier et Philanthropie ».

Il y a quelques années, MeilleursAgents a créé une offre dédiée au monde associatif. Elle accompagne les associations et fondations recevant des legs immobiliers dans tout le processus de cession du bien.
Pascal Boulenger a décrypté les spécificités des OSBL pour qui la question de la transparence et de la traçabilité, entre autres, est plus que jamais centrale. Dans le cas notamment de la cession de legs, les structures, de plus en plus contrôlées, doivent être capables de justifier toute valorisation de biens.
Les experts ont ensuite débattu du rapport publié sur la réserve héréditaire et ses 54 propositions, remis à la garde des sceaux le 13 décembre 2019.
Sur le volet philanthropique, ce rapport ne propose que quelques aménagements à la marge sur les nombreux outils déjà en place. Si la réserve héréditaire n’est pas amenée à évoluer en profondeur, demeure la question clé de la mission parlementaire pilotée par Sarah El Haïry et Naïma Moutchou : Comment développer la philanthropie à la française ?
Découvrez le Podcast :
Guy Raymond Cohen est vice-président et fondateur de l’ANACOFI (Association Nationale des Conseils Financiers) et créateur du Grand Prix de la Philanthropie.
Dans cet épisode, vous découvrirez sa vision des bonnes pratiques entre entreprises mécènes et institutions philanthropiques, et le rôle de son Grand Prix de la Philanthropie pour valoriser ces interractions.
Le 26 septembre dernier, les experts du Think Tank de la Philanthropie se sont réunis à l’Institut Pasteur pour un nouveau petit-déjeuner d’échanges. Le Think Tank accueillait Jérôme Fourquet, analyste politique et directeur du département « opinion et stratégies d’entreprise » de l’institut de sondage IFOP, à l’occasion de la sortie de son livre « l’Archipel Français : naissance d’une nation multiple et divisée ».

Son ouvrage souligne la fragmentation sociale actuelle de la France et met en perspective les nombreux bouleversements qui ont transformé la société depuis trente ans. Cette analyse résulte d’un croisement de nombreuses données issues de cartographies électorales, de sondages, mais également d’une analyse pointue de l’évolution des prénoms.
Pour Jérôme Fourquet, l’archipélisation de la société est la conséquence d’une accumulation de phénomènes profonds établis sur le long terme : d’une part la dislocation de deux matrices structurantes de notre pays, la France conservatrice et catholique d’un côté, et la France communiste et laïque de l’autre, mais également l’évolution des mœurs (nouveau rapport au corps, à l’animalité), la perte d’influence des grands médias, la montée en puissance d’un individualisme de masse ou encore l’immigration massive liée à la mondialisation. La société française est une société désormais multiculturelle, qui perd peu à peu ses références et ses valeurs communes.
Face à cette fragmentation de la société, quelle réalité pour la notion d’intérêt général ? Quel nouveau rapport des français à l’engagement ? Quel avenir pour la philanthropie en France ? À travers cette étude, Jérôme Fourquet propose aux experts d’échanger sur les impacts de cette archipélisation de la société sur le monde associatif et la générosité.
Découvrez le Podcast :
Les experts du Think Tank de la Philanthropie se sont réunis le 20 juin dernier, à l’Institut Pasteur. Lors de cette matinée, ils ont pu échanger avec Sabine Roux de Bézieux accompagnée de Tessa Berthon, de l’association Un Esprit de Famille, sur les tendances et enjeux des fondations familiales, et leur volonté de faire de ce modèle le moteur du développement d’une philanthropie à la française.
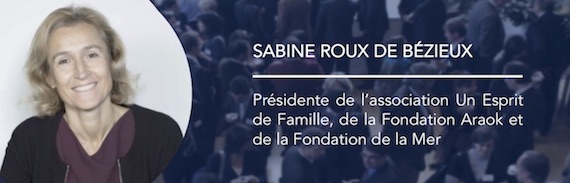
Depuis le milieu des années 2000, un fort développement du montant des dons a pu être observé en France. Malgré ces chiffres qui reflètent un dynamisme du secteur, notre pays reste encore très en retard à l’échelle mondiale. Un retard qui peu notamment s’expliquer par le contexte national : la France possède un taux de prélèvements obligatoires à 48%, bien au-dessus de nombreux pays tels que les États-Unis. De plus, contrairement au modèle américain où la philanthropie s’installe comme le principal financeur de la santé, l’éducation ou la culture, c’est à l’État d’endosser ce rôle en France. Pour Sabine Roux de Bézieux il faut donc voir comme une chance le fait que les philanthropes français soient aujourd’hui aussi nombreux à contribuer au financement de ces secteurs, et plus largement aux enjeux sociaux du pays.
Pour renforcer la philanthropie française, Un Esprit de Famille partage sa volonté de développer une culture du don sur plusieurs générations, celle-ci ne pouvant se développer dans l’esprit des Français du jour au lendemain. En effet, l’une des forces de la philanthropie familiale n’est autre que sa capacité à pouvoir s’inscrire dans un temps long.
Les experts du Think Tank ont débattu de la diversité des statuts existants pour les fondations (FRUP, fondation sous-égide, fonds de dotation, etc.) qui ne facilite pas leur bonne compréhension. Face à la complexité du système actuel, Un Esprit de Famille milite pour une simplification des statuts : sur le même modèle que celui des entreprises, le terme « fondation » devrait être un même et unique statut, imposant des obligations variables tout au long de l’évolution d’une structure. En ce sens, l’association propose la création d’un label « fondation familiale » qui serait attribué aux FRUP, fondations sous égide, et aux fonds de dotation.
L’exposition « Générosité. Droit au cœur » est la première exposition grand public dédiée à la générosité, présentée en 2022 au Musée de la Civilisation de Québec.
Joanne Lacoste, chargée de projets au sein du Musée, revient sur l’origine, la mission et la mise en place de l’exposition.
Tribune de Stéphanie Fournel, coordinatrice du Think Tank de la Philanthropie de l’Institut Pasteur, le 18 avril 19.

Stupeur et sidération après l’incendie de Notre-Dame : la flèche et la charpente s’effondrent. Un monument exceptionnel à plus d’un titre, disparait sous nos yeux.
Nait alors un énorme élan de générosité et une vague de dons qu’on ne soupçonnait pas, prompte à renouveler l’espoir en une société unie et solidaire.
Les professionnels de la philanthropie ont su se mobiliser très rapidement, pour trouver le réceptacle le plus efficace à l’afflux spontané des dons. Le gouvernement, dans sa volonté de rebâtir, a mis en place rapidement, en concertation avec tous les acteurs de la philanthropie, un site Internet reprenant les quatre principaux acteurs habilités à recevoir des dons pour Notre Dame : https://www.rebatirnotredamedeparis.fr/
Il s’agit de la Fondation de France, la Fondation du Patrimoine, La Fondation Notre Dame sous l’égide de la Fondation Avenir du Patrimoine et de la Fondation des Centres des Monuments Nationaux.
Notre Think Tank de la philanthropie salue la mise en place de mesures exceptionnelles, notamment en terme de défiscalisation.
Jusqu’à maintenant, un don de cette nature permettait d’obtenir une réduction d’impôt à hauteur de 66 % du versement pour les particuliers, dans la limite de 20% des revenus imposables, et de 60% du versement pour les entreprises (loi relative au mécénat dite « Loi Aillagon »).
De plus, certains députés veulent soutenir une proposition de loi permettant d’inscrire la cathédrale de Notre-Dame de Paris comme « trésor national », afin que les donations consenties par les particuliers et les entreprises pour la reconstruction de la cathédrale puissent être éligibles à la réduction d’impôt maximal, à savoir 90% du montant versé.
En attendant, pour les particulier, la réduction fiscale est passée à 75% du montant jusqu’à 1 000 euros, et restera à l’ancien taux au-delà.
3 jours après le drame, plus de 15 millions d’euros ont été collectés auprès des particuliers via ces plateformes, plus de 700 millions d’euros ont été levés, spontanément grâce à l’implication des grandes fortunes françaises, qui espèrent entraîner dans leur sillage les grands philanthropes étrangers. 200 millions d’euros chacun pour Bernard Arnault (LVMH) et la famille Bettencourt (L’Oréal), 100 millions d’euros pour la famille Pinault (Artémis) ou encore Total. C’est 10 fois ce que fait le Téléthon. Et la preuve que tous peuvent, face à l’urgence, se mobiliser spontanément, pour agir !
Est reproché aux grandes fortunes leur cynisme, la défiscalisation dont ils feront usage et donc in fine le poids pour les contribuables français.
Et pourtant, certains y renonceront (la famille Pinault), et des organismes, comme la plateforme de collecte Commeon, décident de ne prendre aucune commission ou frais de plateforme.
Notre Think Tank de la philanthropie se réjouit de cet élan et veut alerter : ne nous trompons pas de débat !
Toutes ces initiatives, qu’elles soient issues de la très grande philanthropie, des initiatives locales d’entrepreneurs, d’artisans, de commerçants, mais aussi des dons de tous les anonymes, sont indispensables et ont la même valeur ! Tous, à leur manière, agissent dans un seul but : sauver notre patrimoine.
Ne nous opposons pas, et faisons de ce drame un message, un exemple !
Que ce sujet permette la réconciliation nationale, qu’elle soit la première pierre vers la reconstruction de Notre Dame, mais aussi d’une société pacifiée, où nous pouvons aborder de la même manière tous les projets que les Français ont à cœur : la solidarité, le logement, l’environnement, la recherche et la santé.
Le 14 mars dernier, les experts du Think Tank de la philanthropie se sont réunis à l’Institut Pasteur. À l’occasion de ce petit-déjeuner, le Think Tank accueillait Mme Sarah El Haïry, députée de Loire-Atlantique, dans le cadre de la mission parlementaire qui lui a été confiée sur l’assouplissement éventuel de la réserve héréditaire. Cette mission s’inscrit dans une dimension plus large : celle du développement d’une philanthropie « à la française ».

Au cours de riches échanges, plusieurs questions ont été soulevées. Faut-il conserver la réserve héréditaire ? Comment développer et valoriser la philanthropie des plus fortunés en France ? Comment encourager la donation par les héritiers ?
Aujourd’hui, le potentiel philanthropique de la France reste encore peu exploité. En comparaison à d’autres pays du monde, la très grande philanthropie française est quasiment inexistante malgré une envie émergente de la part des plus fortunés.
Les experts ont partagé plusieurs constats : premièrement, la philanthropie française s’inscrit dans un système juridique encore trop complexe (statuts de fondations divers, etc.), qui ne facilite pas sa bonne compréhension. Il existe également un réel manque de communication des outils à disposition des Français, notamment les outils liés à la donation du vivant, alors même que les possibilités de donner sont multiples (donation temporaire d’usufruit, donation de nue-propriété, donation-partage, etc.).
À cela s’ajoutent un contexte fiscal instable, ainsi qu’une méfiance générale des Français au sujet de leur avenir.
Tant de facteurs qui tendent à freiner le développement d’une philanthropie française à plus grande ampleur.
Découvrez le Podcast :
Pour démarrer cette nouvelle année, les experts du Think Tank de la Philanthropie se sont réunis le 17 janvier à l’Institut Pasteur pour un moment riche d’échanges.
Gabrielle Fack, maître de conférence à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, associée à l’École d’économie de Paris et dont les travaux de recherche portent sur le financement privé des biens publics via la philanthropie et Alix Myczkowski, élève à l’École normale supérieure Paris-Saclay, étaient invitées à venir présenter leur livre Biens publics, charité privée : comment l’État peut-il réguler le Charity Business?

À partir de données historiques, leur étude met en lumière les différences de philanthropie dans le monde. Elle explique notamment l’écart important entre les modèles anglo-saxon et français et tente de répondre à plusieurs questions : Comment se situe la générosité en France par rapport à d’autres pays ? Quel est le rôle des incitations fiscales ? Ont-elles le même impact en France et aux États-Unis ? Quelles sont les motivations des donateurs ?
L’analyse a permis aux chercheuses de mettre fin à plusieurs idées reçues : la forte implication des américains dans la philanthropie n’est pas liée à l’accroissement des inégalités dans le pays. Elle n’est pas non plus conditionnée par les incitations fiscales, qui sont par ailleurs plus élevées en France. Ces observations s’ajoutent à des éléments socio-culturels : le don aux États-Unis est soumis à moins de contrôle par l’administration, et est très fortement lié au culte.
Enfin, les experts du Think Tank ont échangé sur l’impôt sur les successions et ses éventuelles évolutions, en s’appuyant sur la note de Terra Nova « Réformer l’impôt sur les successions » paru le 4 janvier 2019. Ce sujet d’actualité, ainsi qu’une éventuelle réforme du droit des successions, seront traités plus en profondeur lors d’un prochain petit-déjeuner du Think Tank.
Le 8 novembre dernier, les experts du Think Tank de la Philanthropie se sont réunis à l’Institut Pasteur pour la cinquième session de l’année, à l’occasion d’un petit-déjeuner de travail. L’invitée de marque, Sophie Faujour, représentante de la France à l’European Venture Philanthropy Association (EVPA) a présenté les grands principes de la venture philanthropy ainsi que son impact à l’échelle européenne. L’ensemble des experts ont pu débattre sur ce sujet, avant d’évoquer les enjeux d’une refonte possible de la loi de 1905.

L’EVPA, crée il y a 15 ans, est le réseau européen des fondations et investisseurs à impact social en Europe. En plein essor, la venture philanthropy répond aux enjeux des organisations qui recherchent un changement systémique et un impact transformateur sur leur écosystème. L’EVPA observe pourtant quelques freins à son action en France et en Allemagne, en raison de l’absence d’outils juridiques pour donner forme à ces projets.
Le caractère désintéressé de la venture philanthropy a été remis en question par certains experts, qui ont soulevé plusieurs points de controverse : la venture philanthropy est-elle vraiment une démarche philanthropique, au regard de son caractère financier affirmé ? L’impact financier ne prend-il pas parfois le dessus sur l’impact sociétal ? Enfin, comment désigner les acteurs de la venture philanthropy : sont-ils des donateurs, ou des investisseurs ? On peut penser que le terme d’investisseur porte une connotation qui est en contradiction directe avec la mission altruiste de la venture philanthropy.
Enfin, les experts du Think Tank ont évoqué les enjeux d’une refonte éventuelle de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, dite « loi de 1905 ». Ce projet semble concerner essentiellement les associations musulmanes ainsi que les associations cultuelles de 1901, pour lesquels le gouvernement souhaite appliquer la loi de 1905 dans l’objectif d’un meilleur contrôle.

